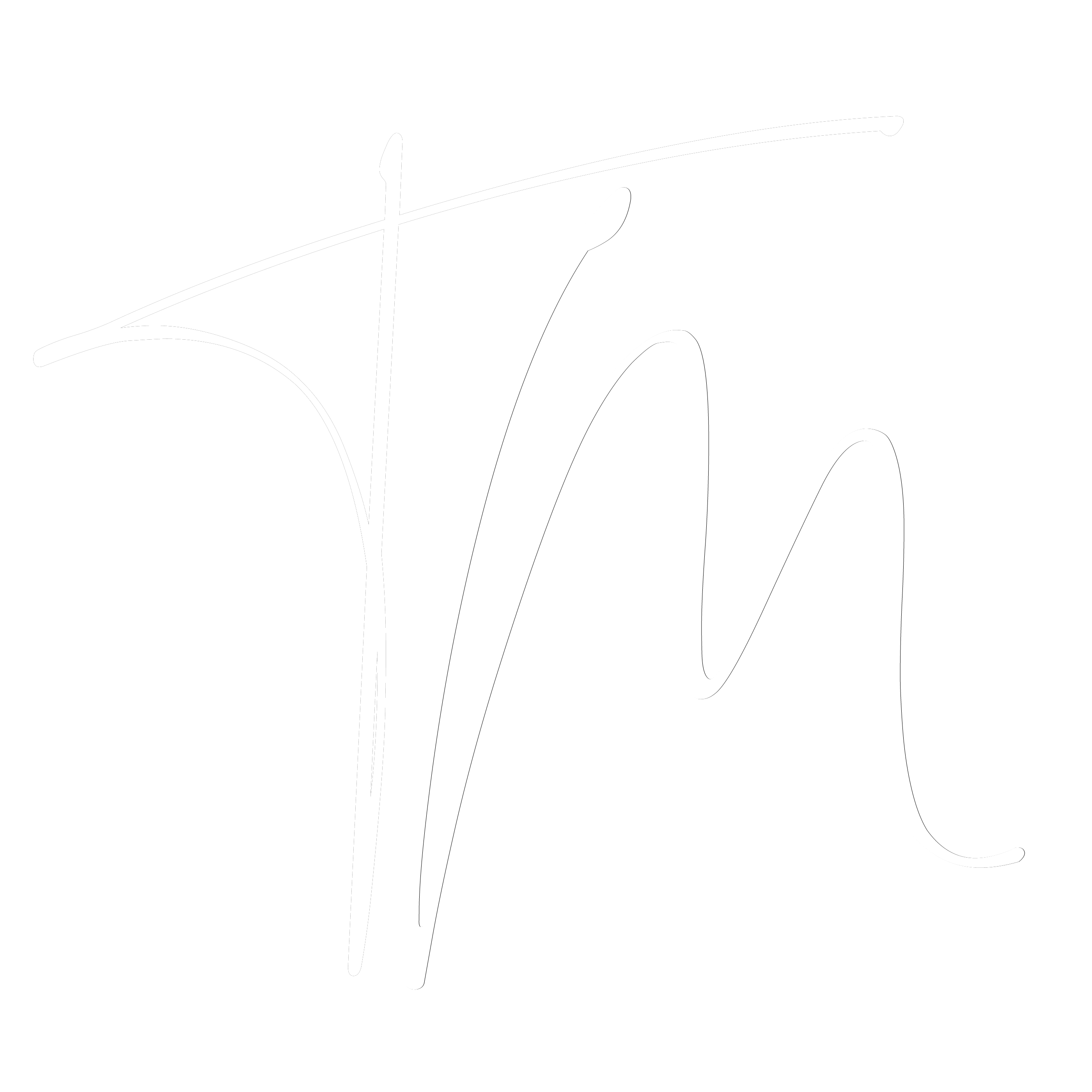De lumière et de souffle
de Théo Michel (2022, 17 min)
Réalisation, image et montage
Théo Michel
Assistant caméra + etalonnage
Léo Henry
Matériel : leohenry.fr
Nathan Lavallart
Théo Michel
Assistant caméra + etalonnage
Léo Henry
Matériel : leohenry.fr
Nathan Lavallart
Note d’intention
Chercher à « mettre en scène » en documentaire, n’est-ce pas chercher à réaliser une stimulante rencontre ? La rencontre entre le filmant et la caméra, entre la caméra et le sujet, le film et le spectateur. Après un an de travail, de réflexion, de doute, de remises en question, je m’aperçois avant tout que ce qui se dessine dans cette première esquisse c’est la rencontre du filmant (moi) avec un espace (l’univers forestier), comme une entrée en matière. Le film pourrait se résumer à cette rencontre. Le film, qui n’a pas été celui initialement et idéalement prévu, a intuitivement suivi ce que la forêt lui a laissé entrevoir. Ainsi, je vois le processus documentaire comme une rencontre avec le réel et sa matière.
En faisant l’expérience de mon film et en écoutant mes camarades de promotion parler du leur, je réalise que cette rencontre devient une force de transformation des esprits, comme un moyen d’explorer un territoire d’où peut jaillir une œuvre, une pensée, une expérience. Si la structure et les formes changent en cours de route, au gré de l’expérience – grâce à ces rencontres, ces phénomènes, etc. – n’avons-nous pas tout à gagner à se laisser guider sans se perdre vers ce chemin qu’est le film, entre une écoute particulière du sujet (être réceptif et non passif), de ce qui va se jouer devant la caméra et le micro, et l’intention qui nous guide vers lui (notre idée, nos questions de chercheur) ?
L’envie dès le départ a été de filmer la forêt. Mais pourquoi ? Rétrospectivement, j’ai compris, d’une part, que j’avais toujours eu un attachement particulier pour l’espace forestier que je n’explique toujours pas entièrement, un lieu d’une grande beauté et d’un calme absolu, ce « paradis des sensations ». [1] D’autre part, j’avais toujours été fasciné par sa « reproduction » visuelle, qu’il s’agisse d’une reproduction réaliste ou de ses formes imaginaires. Après avoir été marqué par ces images ou par des espaces lors de balades, je crois que je voulais à mon tour produire de telles émotions. Comment saisir ce qui, dans cet espace, nous touche et m’a toujours profondément touché ? Comment saisir ce qui s’étend devant nos yeux ? Comment faire voir et entendre cet espace ? Comment restituer, par les moyens du cinéma, les dynamiques visuelles et sonores qui traversent une forêt ?





Lorsque j’entends le vent effleurer les branches et les feuilles d’un bouleau, je ne peux m’empêcher de repenser à mon enfance, à l’été et à l’insouciance. Qu’il s’agisse de l’appartement dans lequel j’ai grandi, ou de la maison familiale qui rythme tous les ans mon été, les bouleaux sont plantés là, près de moi, et frissonnent calmement au vent. Ce son me transporte et m’évoque plusieurs souvenirs. Si nous fermons les yeux, nous pouvons avoir l’impression qu’il s’agit du son de la mer (autre élément constitutif de mes souvenirs d’enfance). En réalisant ce film, j’ai compris que, ce qui m’intéresse tant, c’est la charge sensitive des arbres. Comme le disait Jean-François Lacaze et Yves Birot dans leur livre La forêt, « [le] rapport passionnel de l'homme à la forêt ne vient-il pas du fait que les arbres et les peuplements forestiers, plus que tout autre spectacle naturel, ont exercé depuis très longtemps une sorte de fascination sur nos sens et notre imagination ? ». [2]
Corinne Maury, emploi ces termes : « Étendue monumentale, densité verdoyante, écosystème hétérogène, labyrinthe feuillu : la forêt est un monde de l'ailleurs, un pivot pour l'imaginaire, peuplé d'énigmes et de mystères ». [3] Le désir de filmer les arbres et la forêt vient du spectacle visuel et sonore qu’ils nous offrent. Je me souviens avoir été marqué, juste avant de décider de travailler sur ce sujet, par un plan présent dans le film Voyage of Time (2017) de Terrence Malick. Un plan furtif, filmé dans un léger mouvement arrière, nous fait voir, et surtout entendre, le passage du vent dans les arbres. En voyant ce plan, j’ai eu des frissons. Cela me rappelait-il mon enfance ? Son réalisme, cette sensation d’y être, étaient-ils la cause de cette soudaine émotion ? Je crois que ce plan m’a fait prendre conscience de deux choses. D’abord, que le cinéma avait la possibilité de nous faire rencontrer la nature et ensuite que le cinéma avait trop rarement effectué ce lien, réduisant pour une grande part la nature à une toile de fond.
Les jours de tournage étaient longs et je restais plusieurs heures dans le lieu. J’ai passé une grande partie de mon temps à observer et à marcher. Il m’arrivait d’observer puis de filmer, ou de filmer pour observer. Il s’agit tout autant de filmer ce que j’observais, mais aussi de filmer pour observer avec curiosité et en me laissant surprendre. [4] Certains plans en longue focale permettaient de voir la vie de ceux dont on entend le son, mais qu’on ne voit pas toujours : les oiseaux. Passer une journée dans la forêt avec une caméra et un micro change considérablement notre expérience de la forêt. Claudine de France dit que l’usage de la caméra modifie le regard de l’observateur sur le réel. Notre perception change, j’étais plus attentif. L’expérience du film m’a révélé tant de choses, il m’a donné le sentiment d’une nouvelle forme de complicité avec la forêt. Je pourrais reprendre les propos de Paul Ricoeur et dire que ce mode « attentif » c’est chercher une innocence de l’œil et des sens, une ouverture d’esprit, un accueil
et où le vrai nom de l’attention n’est pas d’abord anticipation, mais étonnement. [5]
La nature, c'est aussi un rythme, un cycle auquel toute forme de vie est soumise, l'homme aussi. Je voulais faire du film une expérience visuelle et sonore, au fil des jours et des saisons qui passent, alterner les plans pour proposer une variation de couleurs et de formes. La forêt n’est pas seulement constituée d’arbres ou de végétaux de toutes sortes. C’est aussi une atmosphère particulière, une structure sonore complexe, un spectacle d'ombres et de couleurs et, aussi, un réseau d’animaux et d’insectes variés. Je voulais incorporer tous ces éléments. Le soleil est probablement l’élément le plus important sur le plan visuel. Il transforme littéralement la forêt. Je me suis rendu en forêt un jour où le ciel était couvert et la forêt semblait ne plus être la même. Il me fallait alors l’inclure dans l’économie globale du film : composer avec les éléments métrologique. Mais d’autres éléments, sonores surtout, sont aussi à inclure. Le vent, les animaux et les insectes. Parfois guidé par un aspect visuel, ou bien sonore, le tournage s’est rapidement transformé en jeu de piste avec les éléments. Il me fallait réfléchir à la manière de mettre en scène le soleil, tout comme il me fallait penser à une méthode pour approcher les animaux.
Ma recherche part d’une interrogation : À l'heure de cette crise écologique sans précédent, quel rôle les images peuvent-elles administrer dans la mise en place d’un rapport sensible à la nature et au vivant ? Ce choix de sujet est guidé par la conviction (Val Plumwood, Catherine Wells, etc.) que les artistes peuvent apporter une réponse émotionnelle incarnée au paysage, ce qui constitue un moteur essentiel dans la tâche urgente de lutte contre la crise environnementale à laquelle nous sommes confrontés.
Réanimer la nature, pour reprendre les mots de l'écologiste féministe Val Plumwood, c’est chercher à activer notre sensibilité, c’est penser une manière de nous sensibiliser à l’espace que nous habitons.
J’ai très vite eu le désir d’embarquer le spectateur dans une expérience de la forêt où l’espace serait le personnage principal. Il me semblait que la forêt avait besoin qu’on la raconte autrement. Je me suis intéressé à décentrer le regard ; de filmer et de montrer différemment ; de ne plus prendre le corps humain comme le moteur du film.
L’espace me semblait si riche, que j’ai voulu en faire la matière principale de mon récit. Je voulais délivrer le film des contraintes narratives classiques.
Si le film débute par un lever de soleil, le film échappe à la « retranscription d’une journée ». Il mélange le temps, les saisons, les couleurs et la lumière, il construit sa propre narration. On pourrait croire qu'il n'y a pas d'action, mais en réalité il y en a une multitude. De plus, le film suit une logique de couleur : on commence avec ce qui s’apparente à la fin de l’hiver, puis le printemps, l’été, l’automne pour finir sur l’hiver. En réalité, les saisons ne sont pas forcément respectées, mais cette logique m’a aidé à construire le film. Le film se construit à partir de la nature. Sur ce point, à plusieurs moments, le vent semble guider les images, le raccord entre un plan à un autre.
Mon travail ne voulait pas simplement exalter la beauté de la nature, mais surtout de lui donner une véritable présence à l'écran. J’ai appréhendé cet espace comme le lieu de phénomènes à la fois visuels et sonores. Je me suis sans cesse interrogé sur la manière dont les films mêlent intimement la construction d’une image du monde, l’expression d’un sujet, et l’élaboration d’une forme singulière. Je voulais que mon film prenne l’allure d’une balade et qu’à la fin le spectateur ait eu l’impression d’avoir vécu quelque chose. L'idée c'était de provoquer une rencontre.
J’ai très vite eu le désir d’embarquer le spectateur dans une expérience de la forêt où l’espace serait le personnage principal. Il me semblait que la forêt avait besoin qu’on la raconte autrement. Je me suis intéressé à décentrer le regard ; de filmer et de montrer différemment ; de ne plus prendre le corps humain comme le moteur du film.
L’espace me semblait si riche, que j’ai voulu en faire la matière principale de mon récit. Je voulais délivrer le film des contraintes narratives classiques.
Si le film débute par un lever de soleil, le film échappe à la « retranscription d’une journée ». Il mélange le temps, les saisons, les couleurs et la lumière, il construit sa propre narration. On pourrait croire qu'il n'y a pas d'action, mais en réalité il y en a une multitude. De plus, le film suit une logique de couleur : on commence avec ce qui s’apparente à la fin de l’hiver, puis le printemps, l’été, l’automne pour finir sur l’hiver. En réalité, les saisons ne sont pas forcément respectées, mais cette logique m’a aidé à construire le film. Le film se construit à partir de la nature. Sur ce point, à plusieurs moments, le vent semble guider les images, le raccord entre un plan à un autre.
Mon travail ne voulait pas simplement exalter la beauté de la nature, mais surtout de lui donner une véritable présence à l'écran. J’ai appréhendé cet espace comme le lieu de phénomènes à la fois visuels et sonores. Je me suis sans cesse interrogé sur la manière dont les films mêlent intimement la construction d’une image du monde, l’expression d’un sujet, et l’élaboration d’une forme singulière. Je voulais que mon film prenne l’allure d’une balade et qu’à la fin le spectateur ait eu l’impression d’avoir vécu quelque chose. L'idée c'était de provoquer une rencontre.
Théo MICHEL



[1]
Jean Mottet, Pour l’Arbre et pour l’Oiseau, les éditions du Ruisseau, 2021, p. 47.
[2]
Yves Birot, Jean-François Lacaze, La forêt, Flammarion, 1994, p. 6.
[3]
Corinne Maury, Du parti pris des lieux dans le cinéma contemporain, Harmann, 2018, p. 107.
[4] Christian Lallier qui parle de l’approche de Frederic Wiseman, « Je filme pour observer », in Pour une anthropologie filmée des interactions sociales, édition des archives contemporaines, 2009, p. 54.
[5]
Paul Ricoeur, Anthropologie philosophique, Ecrits et conférences 3, Éditions du Seuil, 2003, p. 57.